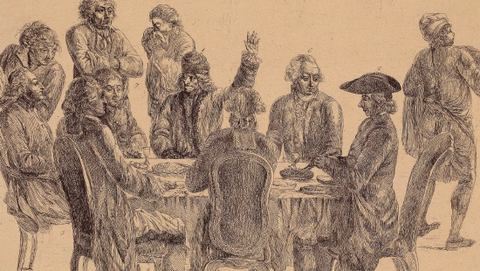
Voltaire et la presse
-
Du 19 juin. 2025 au 20 juin. 2025
-
09:30 - 16:00
-
Europe des Lumières
-
Maison de la Recherche
Bibliothèque nationale de France
-
Renaud Bret-Vitoz, Myrtille Méricam-Bourdet, Dario Nicolosi
À un moment où les corpus périodiques du XVIIIe siècle sont très largement accessibles en ligne, et commencent à pouvoir être exploités efficacement par différents outils liés à l’intelligence artificielle, la Société des Études Voltairiennes souhaite réexaminer les liens entre Voltaire et la presse de son époque. Le mépris de Voltaire pour les journalistes contemporains est bien connu, de même que ses déclarations à l’emporte-pièce sur le peu d’intérêt qu’il accorde aux journaux. Cette posture ne résiste cependant pas à l’examen de sa correspondance, qui atteste au contraire un certain nombre de liens avec les rédacteurs de plusieurs périodiques de son époque. Et encore n’avons-nous sans doute accès qu’à une infime partie de ce qui s’est joué de son vivant, par des liens directs lorsque Voltaire était à Paris, ou par le biais de ses proches (Thiriot, Mme Denis, etc.) qui ont servi de relais. Les Journées Voltaire se proposent donc d’interroger les liens que Voltaire a entretenus avec la presse de son époque de manière extensive, en réexaminant des corpus jusque-là moins accessibles dans les collections.
On souhaiterait en premier lieu que ces liens soient explorés par le biais de la présence même des textes voltairiens dans les périodiques. Quels textes se trouvent publiés ? dans quels journaux ? à quelles dates ? Existe-t-il des traces externes indiquant que Voltaire a été acteur de ces publications, qu’il a pu chercher à solliciter ? Les subit-il au contraire ? Ou bien encore en bénéficie-t-il sans avoir cherché à les favoriser dans le cas de certains périodiques ? Autrement dit, on cherchera à préciser ce que peut recouvrir l’expression de « collaboration médiatique » (D. Droixhe) qui a pu être employée pour désigner ces liens, et qui sont sans doute extrêmement variables d’un périodique à un autre.
On examinera ainsi à nouveaux frais les relations que Voltaire a établies avec les journalistes de son époque, en prêtant aussi une attention particulière au contexte de publication des périodiques (en France ou à l’étranger, avec autorisation ou non, etc.), et aux types de textes mêmes que ces périodiques publient – ou ne publient pas. À côté des imprimés séparés ou des recueils d’oeuvres, de quelle nature est l’oeuvre voltairienne qu’impriment les différents journaux ? Conserve-t-on par ailleurs des traces de la réception des textes ainsi diffusés, et de la perception qu’en ont eue les contemporains ? On pourra donc aussi chercher à mesurer l’influence possible de la publication de l’oeuvre par le biais des périodiques, qui ont eux aussi contribué à sa diffusion.
On pourra enfin considérer la réception critique des oeuvres voltairiennes en leur ensemble (contes, ouvrages historiques, scientifiques ou philosophiques, théâtre représenté et/ou édité, etc.) au sein des périodiques, tout en la situant de manière précise par rapport au(x) genre(s) de la critique littéraire qui se met en place au cours du XVIIIe siècle. Sans se limiter à l’étude des discours idéologiquement situés de tel ou tel journal, et qui ont déjà pu faire l’objet de travaux, l’examen pourra aussi mettre en valeur la place qui est accordée – ou non – à Voltaire au sein de la sphère littéraire relativement aux autres auteurs contemporains, et détailler les modalités pratiques utilisées par la presse à cette fin (comptes rendus critiques rédigés par les journalistes, recueils d’anecdotes, publication de poèmes ou de lettres envoyés par des tiers, etc.).
